Qu’est-ce que la data territoriale ?
La donnée – ou « data » – est aujourd’hui omniprésente dans le monde public comme dans le privé. Mais lorsqu’on parle de data territoriale, il s’agit d’un univers bien spécifique, directement relié aux réalités des territoires, à leurs habitants, à leurs activités et aux décisions locales. Pour les agents des collectivités territoriales, comprendre ce qu’est la data territoriale, comment elle se structure, comment l’exploiter et avec quels outils, devient un enjeu clé d’efficacité, d’équité et de pilotage stratégique. Cet article propose une plongée claire et progressive dans cet univers, en mettant un accent particulier sur les données foncières, fiscales et économiques.
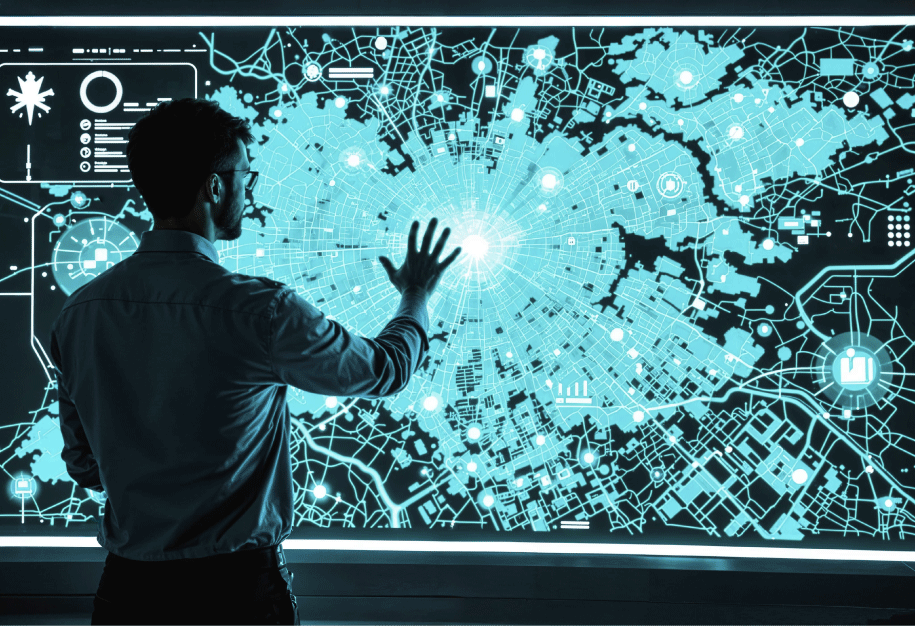
Qu’est-ce que la data territoriale ?
Un guide pour les agents des collectivités
1. Comprendre la data territoriale : de quoi parle-t-on ?
Définition simple et accessible de la donnée territoriale
La data territoriale, c'est l'ensemble des informations structurées qui décrivent un territoire : ses habitants, ses équipements, ses activités, ses infrastructures, son foncier, etc. Elle peut prendre la forme de tableaux, cartes, graphiques ou bases de données.
Quelques exemples parlants :
- le nombre de logements vacants dans une commune,
- la fréquentation d’un arrêt de bus,
- la valeur foncière moyenne dans une zone,
- le taux de chômage d’un quartier,
- ou encore la répartition des zones d’activité économique.
Qui produit et détient ces données ?
Les données territoriales proviennent d’acteurs multiples :
- L’État via l’INSEE, la DGFiP, l’IGN, l’ANCT, etc.
- Les collectivités locales elles-mêmes (via leurs services : urbanisme, voirie, social…)
- Des opérateurs publics ou privés : CAF, transporteurs, concessionnaires d’énergie, etc.
- Le monde académique et les associations (études, enquêtes, projets de recherche…)
Données ouvertes vs données internes
On distingue :
- Les données ouvertes (open data) : accessibles librement, souvent anonymisées, en ligne (ex. : data.gouv.fr, data.insee.fr…)
- Les données internes : produites ou collectées par les services d’une collectivité. Ce sont souvent des données « métier », très précises mais peu partagées (ex. : liste des bénéficiaires de l’aide sociale).
Pourquoi on en parle autant aujourd’hui ?
La data est désormais perçue comme un actif stratégique, au même titre qu’un patrimoine ou un budget. Plusieurs raisons expliquent cette montée en puissance :
- Des réglementations favorisent la transparence, la redevabilité et l’évaluation des politiques publiques.
- La transformation numérique facilite la collecte, le traitement et la visualisation des données.
- Les outils d’analyse et de pilotage se développent, rendant la donnée plus accessible aux non-spécialistes.
2. À quoi sert la data pour un territoire ?
Mieux comprendre son territoire
La première fonction de la donnée territoriale est d’offrir une vision objectivée du territoire. Cela permet de :
- Cartographier les réalités sociales, économiques, urbaines ou environnementales
- Repérer les fragilités (zones sous-dotées, précarité énergétique, désert médical…)
- Identifier les dynamiques positives (nouvelles entreprises, attractivité résidentielle…)
Appuyer les décisions et les politiques publiques
La donnée permet de prendre des décisions fondées sur des faits. Par exemple :
- Prioriser une rénovation urbaine sur un quartier dégradé
- Évaluer l’impact d’une politique jeunesse après 3 ans
- Ajuster l’implantation de nouveaux services publics
Piloter les services publics
Les services disposent souvent de données précises mais sous-utilisées. En les croisant et en les visualisant, ils peuvent :
- Suivre des indicateurs de fréquentation, de coûts, de satisfaction
- Identifier des surcoûts ou sous-utilisations
- Réorganiser les équipes ou les horaires pour plus d’efficience
Rendre des comptes et communiquer
Dans une logique de transparence, les données servent aussi à :
- Valoriser les résultats obtenus (logements créés, aides versées…)
- Répondre aux obligations réglementaires de publication
- Engager les citoyens via des données accessibles et compréhensibles
3. Quels types de données pour les collectivités ?
Données sociodémographiques
Elles décrivent la population :
- Nombre d’habitants, évolution démographique
- Âge, structure familiale, niveaux de revenus
- État de santé, insertion, précarité, mobilité
Ces données sont utiles pour planifier l’action sociale, les écoles, les services de proximité.
Données géographiques et foncières
Elles s’appuient souvent sur le cadastre et les bases de l’IGN :
- Occupation du sol, zonages PLU, parcelles cadastrales
- Réseaux, servitudes, équipements, projets d’aménagement
- Valeurs foncières, typologies d’habitat
Elles permettent de suivre la dynamique urbaine, d’anticiper les besoins en foncier, ou de gérer l’équilibre logement/activités.
Données économiques et fiscales
Elles éclairent le développement territorial :
- Nombre et typologie d’entreprises, secteurs d’activité
- Chiffre d’affaires local, dynamiques commerciales
- Données fiscales : bases de taxe foncière, CVAE, taxe d’habitation résiduelle
Ces données sont essentielles pour optimiser les recettes fiscales et accompagner les acteurs économiques locaux.
Données issues des services publics
Chaque service produit des données utiles :
- Voirie (état des routes, nombre d’interventions)
- Déchets (quantités collectées, fréquence…)
- Petite enfance (demandes, capacités d’accueil)
- Action sociale (aides, bénéficiaires, orientations…)
4. Pourquoi la data territoriale est-elle devenue incontournable ?
Pour éclairer les décisions locales
La donnée est le socle de toute décision fondée. À l’heure de la complexité croissante des politiques publiques, elle permet d’objectiver les constats, de cibler les actions, de justifier les choix et d’évaluer les résultats.
Quelques exemples :
- Identifier un besoin de logement social grâce à l’évolution démographique ;
- Décider de la localisation d’un équipement public via l’analyse des flux ;
- Moduler la fiscalité en fonction du potentiel économique réel du territoire.
Pour piloter et anticiper
La donnée ne sert pas qu’au diagnostic, elle permet aussi de piloter dans la durée, de détecter les signaux faibles, d’anticiper des tendances :
- Évolution des bases fiscales (ex. valeur locative, nombre de locaux) ;
- Mutation du tissu économique (apparition de zones vacantes, reconversion foncière) ;
- Pression foncière et prix du marché (via les bases DVF).
Pour garantir l’équité territoriale
Travailler sur des données fiables, croisées et actualisées est une condition de justice territoriale : éviter les politiques à l’aveugle, identifier les zones sous-dotées, repérer les effets de seuils. C’est aussi un moyen de lutter contre les inégalités d’accès aux services publics.
Pour répondre aux exigences de transparence
Les citoyens demandent davantage de lisibilité, de redevabilité et de participation. La data territoriale contribue à cette démocratie de la donnée : communication de bilans, open data, concertations éclairées par des diagnostics.
5. Comment exploiter concrètement la donnée ?
Collecter et structurer la donnée
Trop souvent, les données sont éparpillées, hétérogènes, peu lisibles. Il faut :
- Centraliser les sources dans un référentiel partagé
- Nettoyer les doublons, harmoniser les formats
- Documenter les données pour qu’elles soient compréhensibles
Visualiser les données
La visualisation permet de rendre les données compréhensibles et actionnables :
- Cartes interactives : localisation des besoins ou des équipements
- Tableaux de bord : suivi d’indicateurs clés (logement, budget, emploi…)
- Graphiques : évolution temporelle, comparaisons entre quartiers
Croiser et analyser les données
L’analyse croisée est très puissante. Quelques exemples :
- Croiser précarité et logement pour cibler les aides
- Croiser fréquentation d’un service et profil des usagers pour adapter l’offre
- Croiser foncier disponible et activité économique pour identifier des sites à développer
Organiser un écosystème local de la data
La donnée n’est pas l’affaire d’un service isolé. Il faut :
- Impliquer les directions métiers, les DSI, les services stratégiques
- Créer une gouvernance de la donnée (comité, référents, chartes)
- Favoriser la mutualisation entre collectivités, notamment via des syndicats mixtes ou des observatoires partagés
Des outils concrets au service des collectivités
Face à la complexité croissante, des solutions logicielles spécialisées existent pour accompagner les collectivités dans l’exploitation de leur data territoriale. On peut citer par exemple nos observatoire territoriaux :
- L’Atelier Fiscal : plateforme d’analyse des bases fiscales locales, pour identifier les marges de manœuvre et suivre les recettes.
- L’Atelier Économique : outil d’analyse de la dynamique économique, de l’emploi et de l’immobilier d’entreprise.
Ces observatoires territoriaux permettent de passer d’une masse de données brutes à des outils d’aide à la décision concrets adaptés aux besoins concrets des agents, même sans formation poussée en data.
6. Et l’intelligence artificielle dans tout ça ?
Ce que l’IA peut faire (et ne pas faire) pour les collectivités
L’IA est prometteuse mais elle n’est pas magique. Elle peut :
- Prédire des besoins (ex. : fréquentation d’un équipement selon la météo)
- Automatiser des réponses (ex. : chatbot pour questions simples)
- Analyser des images (ex. : détection de dépôts sauvages sur photos de drones)
Mais elle ne remplace ni le jugement, ni la connaissance du terrain.
L’IA a besoin de données locales fiables
L’efficacité de l’IA dépend entièrement de la qualité et de la contextualisation des données. Une IA entraînée sur des données incomplètes ou biaisées produira des résultats faux ou inutiles.
Premiers pas : utiliser des outils intégrant de l’IA
Des outils métiers commencent à intégrer des briques d’intelligence artificielle :
- Prévision d’affluence dans les équipements
- Aide à la rédaction de documents
- Détection automatique d’anomalies dans les dépenses ou les signalements
Enjeux éthiques et juridiques
L’usage de l’IA dans les collectivités pose aussi des questions importantes :
- Protection des données personnelles : secret fiscal, données sociales sensibles…
- Transparence des algorithmes : comprendre comment les décisions sont prises
- Éviter les biais : certaines IA peuvent reproduire des discriminations involontaires
C’est pourquoi les usages de l’IA doivent toujours s’accompagner d’une gouvernance humaine éclairée.
Conclusion
La data territoriale est bien plus qu’un concept à la mode : c’est un outil de pilotage, un levier de transformation, une clé de lecture du territoire. Pour les collectivités, s’emparer de ces données – foncières, fiscales, économiques, sociales – devient une nécessité pour agir efficacement.
Encore faut-il structurer l’écosystème, mutualiser les compétences, s’équiper des bons outils (observatoires, visualisations, tableaux de bord), et rester attentif aux usages. La donnée seule ne fait rien : c’est son interprétation, son partage, son usage concerté qui font la différence au service des habitants.
S’inscrire à la Newsletter
Recevez chaque trimestre notre newsletter avec les dernières actualités fiscales et économiques, les évolutions de nos logiciels et les événements à ne pas manquer.
Inscrivez-vous pour ne rien rater !























